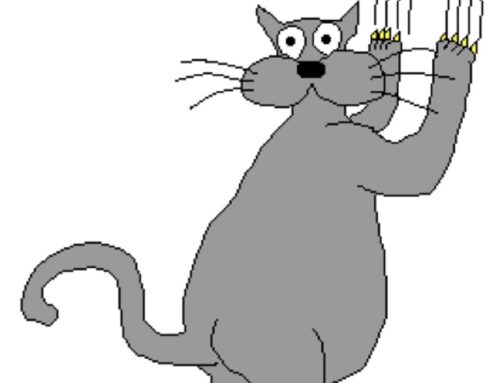… Comme un chien dans un jeu de quilles
Quand on vient tout juste d’adopter un chiot et que dès la première nuit, il ronge les pieds des meubles et renverse la poubelle avant d’en trimballer le contenu un peu partout dans la maison… On ne peut pas dire que ça fasse plaisir, mais on s’y attendait quand même plus ou moins. Quand le chiot ne s’est toujours pas calmé six mois, voire trois ans plus tard, ça devient franchement agaçant. Que peut-on faire donc pour calmer les ardeurs de ce tsunami, et qu’est-ce qui peut bien pousser un chien adulte à continuer à tout casser ? C’est ce que nous allons essayer d’éclaircir dans cet article.
Mais pourquoi il détruit, ce chien ?
De multiples raisons peuvent pousser un chien à détruire, mais on peut les regrouper en deux grandes catégories, qui nous conduiront à considérer certaines destructions comme « normales », et d’autres comme pathologiques. Cette distinction n’a pas qu’un intérêt théorique, puisqu’elle va conditionner le pronostic et le traitement.
Les destructions « normales »
C’est toujours un peu difficile à admettre lorsque l’on trouve sa maison dévastée, mais certaines destructions sont normales. Un jeune chien qui déterre les rosiers, qui détruit le système d’arrosage ou qui sectionne la fibre Orange, (mais pourquoi elle marche plus, la télé ?)… cela fait partie des comportements exploratoires normaux du chiot (plus ou moins attardé). Déchiqueter ses coussins parce que c’est vraiment très amusant cette mousse qui vole partout, (photo ci-dessous), on peut dire que c’est un comportement de jeu normal.


Il n’y a rien à dire : dépiauter son coussin, il n’y a vraiment rien de plus drôle dans la vie d’un petit chien !
Qu’un jeune chiot hurle jusqu’à deux heures du matin les premières nuits parce qu’on a décidé qu’il devrait dormir dans la cuisine et pas dans les chambres, et que le matin, on trouve tous les pieds des chaises rongés… cela est normal également. Ce qui différencie le normal du pathologique, c’est que dans ces différents exemples, il s’agit d’un problème isolé, « logique » dans le contexte, et qui va, normalement, s’améliorer rapidement avec un minimum de constance, de bon sens et d’éducation : on en reparle un peu plus loin.
Les destructions pathologiques
La distinction n’est pas toujours facile à faire avec les destructions « normales », mais dans les cas de destructions pathologiques, plusieurs nuisances sont généralement présentes simultanément, (les destructions ne sont pas un problème isolé), et leur ampleur dépasse le simple comportement de jeu. En plus, dans la plupart des cas, le chien continue ses bêtises alors qu’il a atteint l’âge, disons… de raison. Nous citons ci-dessous quelques exemples parmi les plus fréquents. Il ne s’agit pas de les décrire en détail, d’autres articles devraient bientôt arriver pour ça, mais simplement de donner une idée de la variété des causes (parfois totalement opposées) qui peuvent conduire un chien à détruire, et donc de la variété des attitudes à adopter, et des éventuels traitements à mettre en œuvre.
1 – Le syndrome hypersensibilité-hyperactivité (HSHA)
Le chien n’a pas acquis les auto-contrôles pendant ses premières semaines de vie : il en fait donc toujours trop, dans tous les domaines. Il engloutit sa nourriture, boit comme un trou, vole tout ce qui est à sa portée, fait ses besoins dans la maison, passe des heures à courir sans jamais se fatiguer, mordille tout le monde jusqu’à écorcher les mains… et bien sûr, détruit tout. C’est un chien ingérable, qui n’apprend rien, très gentil au demeurant (du moins au début), mais qui épuise tout le monde et dont on a l’impression qu’on ne pourra jamais rien en faire.
Bon, pas de panique quand même : il y a des degrés dans le syndrome HSHA, et tous les chiens concernés ne cochent pas toutes les cases énumérées ci-dessus ! Et heureusement, il y a des traitements.
Elsa, adorable petite Cotton de Tulear HSHA, en consultation de comportement : pendant deux heures, elle ne s’est à peu près jamais posée, tournant après sa queue, s’attaquant à l’arrêt de porte et ici, s’acharnant sur le matériel jusqu’à le faire tomber, pour ensuite parader avec à travers la pièce ! A la maison, pour se limiter au domaine des destructions, elle fait les poubelles, détruit (un peu), et vole ou déplace des objets. Le point positif, en attendant la mise en place d’un traitement, est la petite taille de la chienne : le même comportement chez un labrador ou un beauceron aurait été beaucoup plus difficilement supportable !
2 – L’anxiété (de séparation en particulier)
Il est normal qu’un chien s’attache aux membres de sa famille d’adoption, mais il arrive que cet attachement, au groupe ou plus souvent à une personne du groupe, devienne excessif. Dans ce cas, le chiens ne trouvera d’apaisement qu’en présence de son « être d’attachement ». En l’absence de cette personne, ou en anticipation d’une séparation, le chien présentera alors des signes de détresse.
Dans ce cas de figure, le chien ne détruit donc pas seulement par jeu ou par ennui, (qui sont également des causes de destructions), mais parce qu’il est paniqué de se retrouver seul, en particulier séparé de son être d’attachement. Dans ce cas, les destructions sont plutôt des dérangements, le chien ayant mis l’appartement ou la maison sens dessus dessous pour s’emparer d’objets portant l’odeur de son/sa maître(sse). D’autres marques d’anxiété sont généralement présentes : urines ou selles molles dispersées au gré des déambulations, auto-mutilations, comportement craintif en général…
3 – Les troubles hiérarchiques
Dans ce cas, le chien (de préférence un jeune adulte mâle), trouve intolérable que l’on s’en aille en le laissant seul derrière une porte fermée, lui qui se considère, (parfois à juste titre !), comme le chef de la meute familiale. Il manifestera alors son mécontentement par des destructions centrées sur les issues (en particulier la porte d’entrée) qui l’empêchent de rejoindre sa meute, qui a eu le toupet de partir en le laissant planté là. On retrouve souvent aussi du marquage urinaire ou fécal, également autour des issues, et le chien dispose de prérogatives dans les domaines de l’accès à la nourriture, de la répartition de l’espace, et des contacts.
4 – Les troubles confusionnels du vieux chien
Il y a quelques siècles, nous mourions tous jeunes, de la peste bubonique ou en guerroyant contre la tribu voisine, et nous ne vivions pas assez vieux pour développer des cancers ou une maladie d’Alzheimer. Il en est de même pour nos chiens qui, pour la plupart, vivent aujourd’hui suffisamment vieux pour développer des troubles confusionnels se traduisant par de la désorientation (déambulations et des vocalises pendant la nuit), et une perte des apprentissages : réapparition de la malpropreté… et des destructions. (Voir la photo en tête de cet article : l’épagneul qui se cache à moitié derrière la porte après avoir tout dévasté a 14 ans ! Et avait cessé ce genre de bêtise avant l’âge de 6 mois).
Plus d’informations sur le syndrome confusionnel du vieux chien en cliquant ici.
Dans les exemples cités ci-dessus, un simple travail d’éducation ne suffira évidemment pas, et une « bonne correction » ne fera qu’aggraver les choses : une discussion avec votre vétérinaire, voire une consultation comportementale seront nécessaires afin d’identifier et de bien définir l’origine du problème, et de mettre en place un traitement adapté.
Il sait qu’il a mal fait !
Quelques idées reçues, auxquelles il convient de tordre le cou !
« Il sait très bien qu’il a mal fait, il prend son air coupable » :
Réflexion souvent entendue, de la part de ceux qui rentrent dans la maison où tout est en petits morceaux, avec couché au milieu, le chien qui baisse la tête et vous regarde par en-dessous, en remuant faiblement la queue – cette réflexion étant généralement le prélude à une bonne rouste.

Le chien ne sait pas qu’il a mal fait. Tout ce qu’il sait, c’est que quand son maître arrive et jette un coup d’œil courroucé sur la pièce, ça va mal se passer pour lui. (D’ailleurs, il est facile de faire le test : vous ouvrez la porte et vous regardez la pièce sans rien dire, d’un air courroucé, même s’il n’y a rien de détruit, et vous verrez le chien prendre son « air coupable »). Ou encore il comprend que quand son maître arrive et que le sol est jonché de débris de coussin (ou d’urines, ou de selles, ou de cages d’oiseaux éventrées…), là aussi, ça va mal se passer. Mais il ne comprend pas que c’est parce qu’il a joué avec les coussins du salon entre une heure et deux heures du matin, qu’il va recevoir une correction à sept heures et demie. Et cela ne l’empêchera donc pas de recommencer le lendemain. La meilleure preuve en étant que jamais une punition administrée à posteriori, plusieurs heures après les faits, n’a résolu ce genre de problème.
En résumé, la rouste pour la bêtise faite une heure plus tôt, certes ça peut soulager, mais ça n’a jamais réglé le problème, et ça peut même en créer d’autres, en augmentant l’anxiété de l’animal. Donc, à oublier.
« On ne l’a pas emmené, alors il se venge ! »
La vengeance est un sentiment humain, que les chiens ne connaissent pas : si l’on veut comprendre ce qui se passe dans la tête du chien, il faut raisonner comme un chien, avec un minimum de connaissances du comportement canin. Et relire les paragraphes ci-dessus : si le chien a tout détruit pendant votre absence, ce n’était pas pour se venger, mais pour s’amuser, ou parce qu’il s’ennuyait, ou parce qu’il avait peur, ou parce qu’il est incapable de se contrôler, ou parce qu’être ainsi laissé ne correspond pas à la manière dont doit fonctionner une meute dans sa logique à lui, ou parce qu’il est confus dans sa tête, etc.
Quel que soit le cas de figure, là non plus, ce n’est pas « une bonne rouste pour lui apprendre qui c’est qui commande » qui va résoudre le problème !
Alors, qu’est-ce qu’on fait ?
Si les destructions sont « normales » :
Le chien n’est pas « malade », il est juste excité, ou bien il s’ennuie, ou bien il n’a pas compris toutes les règles de la maison. Il ne sera donc pas question de traitement, mais d’éducation… et de patience. A ces deux principes, indispensables si l’on prend un chien, pourront s’ajouter, selon le temps et l’énergie dont on dispose, quelques mesures d’évitement bien pratiques… mais à mettre en œuvre avec discernement !
1 – De l’éducation :

Destructions ou pas, l’éducation est tout de même la base de tout. Il est toujours bon qu’un chien soit bien cadré, sans violence, bien sûr, mais qu’il sache très précisément ce qu’il a le droit, et ce qu’il n’a pas le droit de faire – et que toutes les personnes qui entourent le chien soient cohérentes à ce sujet ! Selon le degré d’obéissance de l’animal et les capacités pédagogiques de ses maîtres, l’éducation pourra se faire au sein de la famille, ou en se faisant aider par une éducatrice ou un éducateur canin.
Pour le cas particulier des destructions, la difficulté vient du fait que celles-ci se produisent rarement en présence des maîtres : on trouve le tapis de la cuisine en petits morceaux le matin quand on se lève, et les plates-bandes du jardin dévastées quand on rentre le soir. (Photo ci-contre : en haut, il y a un ampli, en bas il y a une enceinte, et entre les deux… il y avait un câble). Or, on sait qu’une punition n’est efficace que si elle est administrée de façon constante, et au moment où la bêtise est commise. Punir le chien une fois sur deux, et cinq heures après le moment où il a détruit n’aura donc aucune utilité (y compris si on lui met « le nez dedans », et cela est valable aussi pour la malpropreté).
Alors, que faire ? pour tout dire, il n’y a pas de solution simple. On peut d’abord essayer de prendre le chien sur le fait, le plus souvent possible. Mais cela demande beaucoup de temps, et de patience. On se cache, on attend que le chien s’approche de l’objet qu’il a l’habitude de détruire, et au moment où il va le saisir, on intervient : on peut, au choix, taper dans ses mains en criant « NON ! », ou bien surprendre l’animal avec un pistolet à eau, ou encore utiliser un collier télécommandé envoyant une giclée de gaz (le plus souvent parfumé à la citronnelle) ; en aucun cas, un collier à chocs électriques ! (Photos ci-dessous). Si par hasard le chien s’approche de l’objet habituellement détruit, le renifle, et ne s’en empare pas, on peut le féliciter. Mais attention, en éducation canine, on ne récompense pas un non-acte ! La distinction est subtile : si le chien est tenté de prendre l’objet, et finalement y renonce, on peut le récompenser. Mais si l’on arrive le matin dans la cuisine et que pour une fois, rien n’a été détruit pendant la nuit, récompenser le chien n’a aucun sens et ne sera d’aucune efficacité. Les destructions sont donc, par nature, une nuisance sur laquelle récompenses et punitions auront peu de prises.
Outre l’effet anxiogène sur le chien qui se prend une décharge électrique sans trop comprendre pourquoi ni comment, voilà ce que donne un collier électrique mal réglé sur le cou d’un chien qui a eu le malheur d’aboyer, ou de s’approcher d’un endroit qu’il ne fallait pas. (Ici, le chien a été endormi pour pouvoir nettoyer et désinfecter les lésions, évidemment très douloureuses). On a deux énormes trous causés par les électrodes chargées d’envoyer le choc électrique, et la peau autour est bien rouge (flèche bleue), comparée à la peau normale (flèche noire).
À défaut, donc, d’agir sur un comportement qui se produit en l’absence des maîtres, on pourra toujours miser sur l’éducation « générale », toujours souhaitable, de toute façon. N’oublions pas que le chien est un animal social, un animal de meute, « programmé » pour évoluer au sein d’une hiérarchie, canine ou humaine – pour faire simple : un peu plus de nuances dans notre article consacré à la hiérarchie chez le chien). Un chien bien cadré, qui sait où est sa place, qui obéit bien aux ordres de base (« assis », « va coucher », rappel…), se contrôlera mieux et aura moins tendance à tout détruire qu’un chien ent!èrement livré à lui-même. En résumé, apprendre l’ordre « assis » ne fera pas cesser les destructions en quelques jours, mais contribuera indirectement à les faire cesser au fil des semaines ou des mois – à défaut d’agir directement sur la nuisance.
2 – Quelques conseils :
L’expression « Donner un os à ronger à quelqu’un » peut s’interpréter, selon le Littré, par : « lui faire quelque légère grâce pour se délivrer de ses importunités », ou plus couramment : donner à quelqu’un de quoi s’occuper, afin de s’en débarrasser. Eh bien dans le cas du chien destructeur, la formule est à prendre au premier degré, surtout pour les jeunes chiens joueurs, qui s’ennuient, voire un peu HSHA sur les bords : dès qu’on voit Youki s’approcher des chaussures de belle-maman et commencer à les renifler avec gourmandise, on crie « NON ! » et on le réoriente vers une cible plus acceptable ; peut-être pas un vrai os à ronger, (quoique, mais encore faut-il en avoir toujours un sous la main !), mais un kong, un os en caoutchouc, ou équivalent. Et quand il l’a saisi, on prend trente secondes (ou plus) pour le féliciter et lui montrer qu’on est vraiment très content. Et bien sûr, quand on s’absente, tous les jouets en question seront là, à disposition.
Quelques conseils empruntés au site Zoopsy, cette fois plutôt à destination des chiens qui manifestent de l’anxiété quand on les laisse seuls – on est donc à la limite du pathologique, mais bon, ces conseils peuvent faire partie de l’éducation et des recommandations générales pour tous les chiens qui arrivent dans une maison.
- Dès son arrivée, Snoopy doit avoir son coin à lui, avec son coussin ou son panier, situé en dehors des passages pour qu’il y soit tranquille. On lui apprend à y aller (« Va te coucher ! »), et on le félicite s’il obéit. Il doit rapidement aller s’y coucher spontanément, signe qu’il s’y sent bien et qu’il y trouve de l’apaisement. Attention : c’est SON coin, une fois qu’il y est, les enfants ne vont pas l’y déranger, et s’il a fait une bêtise, on ne l’y poursuit pas pour le gronder !
- Dès les premiers jours suivant son arrivée, on entraîne Snoopy à rester seul dans une pièce, porte fermée : d’abord quelques minutes, puis de plus en plus longtemps.
- Très important : quand on s’en va, on évite les grandes démonstrations (« Ma pauvre petite Choupinette, papa et maman s’en vont, mais c’est pour pas longtemps, on revient tout de suite… ») qui sont censés rassurer Choupinette, mais qui l’angoissent encore plus – surtout si elle sent que ses propriétaires sont eux-mêmes anxieux. Donc on l’envoie gentiment se coucher dans son panier, et on part sans se retourner. (Et si l’on peut éviter de se préparer pendant une demi heure avant de partir, c’est encore mieux, parce que l’anxiété du chien grimpe en parallèle). Même chose au retour : un petit bonjour, mais pas de grosses démonstrations avant qu’il se soit calmé. L’idée est que s’il n’y a pas de grosse émotion au départ et au retour, il y a des chances qu’il n’y en ait pas trop non plus entre les deux.
- Evidemment, si on part pour la matinée, on s’assure que Snoopy ait pu sortir dix minutes pour se dégourdir les pattes et faire ses besoins.
- Et puis quand on revient et que malgré tous ces conseils, on trouve sa maison totalement ravagéee… Alors on prend sur soi pour ne pas hurler, et on met Snoopy dehors avant de commencer à ramasser les morceaux.
Et puis une fois que le mal est fait, et là, ça ne concerne plus seulement les chiens anxieux, ce serait plutôt pour les chiens joueurs, qui s’ennuient et/ou HSHA ; quand on rentre et que malgré tous les conseils ci-dessus, on trouve sa maison totalement ravagée… Alors on prend sur soi pour ne pas hurler, et on met Snoopy dehors avant de commencer à ramasser les morceaux. Parce que rien de plus amusant pour un chien que de voir son maître se déplacer à quatre pattes pendant dix minutes pour récupérer tous les débris de chaussures mélangés à la mousse des coussins !
3 – De la patience :
Si les destructions ne sont pas trop importantes ni trop gênantes, et que le chien ne pose pas de problème par ailleurs… eh bien il peut suffire de patienter, et d’attendre que les choses se tassent. Votre chiot de quatre mois fait des trous dans le jardin et déterre tous les rosiers ? Il a rongé le vieux tapis qu’on pensait jeter, de toute façon ? S’il ne vous cause pas d’autre souci, et que vous pouvez vous passer des rosiers pour cette année, et accessoirement du tapis, eh bien on évite de se prendre la tête, on laisse le jardin en friche, et on replantera des fleurs l’année prochaine. À un an et demie, il y a des chances pour que Youki se soit trouvé d’autres centres d’intérêt, et que vous puissiez replanter de nouveaux rosiers, qui pousseront tranquillement, cette fois. On économise beaucoup d’énergie, et peut-être quelques années de vie, en évitant de se stresser pour des choses qui n’ont finalement pas beaucoup d’importance…
Mais naturellement, et on y revient toujours, cela n’empêche pas de faire de l’éducation !


Des trous dans le jardin, et la fin d’un (vieux) tapis : on peut choisir de prendre la chose avec philosophie, et se dire que tant que la créature s’occupe à ça, au moins elle ne détruit rien de plus important !
4 – De l’évitement :
Comme on l’a déjà vu au paragraphe précédent, il y a des fois où il est plus sage de ne pas s’entêter. Vous avez essayé les récompenses, les punitions, le collier télécommandé à la citronelle, les heures d’affût caché derrière la haie de rosiers… et rien n’y fait ? On va, au choix, s’énerver, se décourager, ou plus sûrement les deux à la fois. Donc, à condition, bien sûr, d’avoir exclu des destructions pathologiques avec un vrai trouble du comportement sous-jacent, il est temps de régler le problème simplement par de l’évitement.
Qu’est-ce que l’évitement ? on en a déjà eu un aperçu au paragraphe précédent : plutôt que de s’acharner (en vain) à faire comprendre à Youki qu’il doit arrêter ses destructions, on va juste faire en sorte qu’il n’ait plus rien à détruire. Donc, s’il déchiquette les rideaux du salon toutes les nuits, soit on l’enferme dans la cuisine ou dans le garage, où il y a moins de bêtises à faire… soit on retire provisoirement les rideaux du salon ! (Sur la photo ci-contre, il aurait été pertinent de retirer provisoirement le coussin). S’il met la maison sens dessus-dessous pendant que vous êtes au travail dans la journée, on le laisse dans le jardin (à condition évidemment d’avoir un jardin, et qu’il n’aboie pas six heures d’affilée jusqu’à rendre fous les voisins), ou bien on le confie quelques heures à la belle-mère si celle-ci habite trois maisons plus loin.

Vous pourrez objecter que 1) vous ne voulez enlever ni le coussin ni les rideaux du salon, et 2) ce n’est quand même pas le chien qui va faire la loi. Il faut quand même bien penser que dans la plupart des cas, un chien qui détruit sans présenter un trouble du comportement type HSHA ou sociopathie, est un jeune chien qui se calmera (en général) avant l’âge d’un an. Donc, si on voit qu’on n’y arrive pas et que les destructions commencent à pourrir la vie de la famille, tout en poursuivant bien sûr le travail d’éducation, on fait en sorte que le chien n’ait plus rien à détruire, et on attend quelques mois jusqu’à ce qu’il soit calmé. Ce n’est peut-être pas très satisfaisant d’un point de vue intellectuel et comportemental, mais il faut parfois savoir se montrer pragmatique.
Et si tout cela ne suffit pas, il reste la solution de l’enclos (dans le jardin pendant la journée, ou dans le garage si l’on a la place), du parc à bébés (pour un petit chien), ou du vari kennel ou équivalent, où l’on installe le chien le soir ou avant de s’absenter, avec sa couverture ou son coussin (s’il ne les déchiquette pas), quelques croquettes, et son eau. Attention, il ne doit en aucun cas s’agir d’une brimade ou d’une punition, l’idée n’est pas d’enfermer Youki dans une cage au fond du jardin pour s’en débarrasser : les premières fois, on le fait rentrer dans son kennel dans des conditions de jeu, avec des récompenses si nécessaire et des félicitations une fois qu’il y est installé. Les chiens s’habituent généralement très bien, et après quelques jours où quelques semaines, (voire parfois dès le premier soir), ils rentrent spontanément dans leur enclos ou leur kennel, lorsqu’il est l’heure d’aller se coucher. Soit dit en passant, cette technique est aussi efficace en cas de malpropreté, un chien faisant rarement ses besoins dans son lieu de couchage lorsqu’il ne dispose que d’une surface restreinte.
Re-attention : cette solution n’est envisageable que si Youki adopte son parc ou son kennel et qu’après quelques jours, il y rentre spontanément, et si possible avec plaisir : s’il faut se battre tous les soirs pour l’y faire rentrer, on laisse tomber : ce ne sera pas la bonne solution.

Ci-dessus : un enclos pour chien de grand format : la chienne s’y est installée dès le premier soir, ce qui a évidemment empêché toute destruction nocturne, mais aussi stoppé les besoins dans la maison ; après quelques jours, l’habitude était prise, il était possible de laisser la porte ouverte la nuit. (Bon, ok, ça ne marche pas toujours aussi vite ni aussi bien). Ci-dessus à droite : le gros chagrin le jour du démontage de l’enclos, devenu inutile : « c’est ma maison qui s’en va… »
Ci-contre : un exemple de Vari kennel.
Une fois l’habitude bien acquise, on a le choix entre conserver définitivement le kennel ou l’enclos comme lieu de couchage si Youki s’y est bien habitué, ou bien, après quelques jours, semaines ou mois d’accalmie, laisser la porte de la cage ouverte le soir. Dans la plupart des cas, le chien ayant pris quelques mois d’âge supplémentaires, et ayant eu le temps de perdre ses mauvaises habitudes, les destructions ne reprennent pas après l’ouverture de la porte. Sinon… retour dans la cage !
Si les destructions sont pathologiques :

Là, l’éducation ne suffira pas à résoudre le problème (même si elle reste toujours utile, par ailleurs) : le chien souffre d’un véritable trouble du comportement, et il faut d’abord diagnostiquer celui-ci au cours d’une consultation comportementale, puis le traiter. Pour cela, on utilise une thérapie adaptée (régression sociale dirigée pour un trouble hiérarchique, exercices visant à renforcer les auto-contrôles chez un chien HSHA (photo ci-dessus), détachement et élimination des rituels de départ et de retour chez un chien souffrant d’anxiété de séparation…), et l’on s’aide, si nécessaire, de médicaments. Le but de ces derniers n’est pas de transformer le chien en zombie (ce qui serait contre-productif, puisque l’animal ne pourrait plus rien apprendre), mais, par exemple, de diminuer son seuil d’excitation (HSHA), d’agressivité (sociopathie), ou son niveau d’anxiété (syndrome de privation), afin de le rendre réceptif à la thérapie.